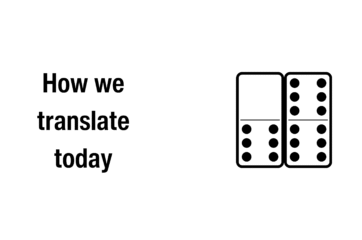Des tablettes d’argile à l’IA :
l’histoire de la traduction
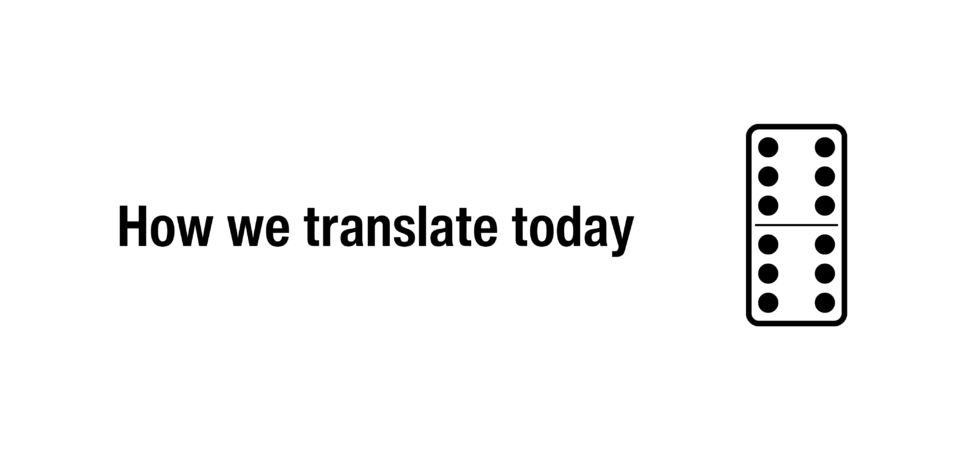
Vous êtes-vous déjà demandé où tout avait commencé ? La première traduction a-t-elle été faite dans la tour de Babel ou sur une tablette d’argile en Mésopotamie antique ? Bien avant la traduction automatique et l’IA, les sociétés essayaient déjà de construire des ponts entre les langues à travers les empires, entre les différentes fois et sur les routes commerciales.
Parcourir l’histoire de la traduction nous aide à mieux comprendre comment elle a façonné le monde dans lequel nous vivons. Des premiers scribes aux linguistes de nos jours, voici l’histoire de la communication, de la culture et de la constante (r)évolution.
1. Argile, écriture cunéiforme et premiers textes bilingues (env. 2000 av. J.-C.)
L’histoire de la traduction remonte à la Mésopotamie, environ 2000 av. J.-C. Les tablettes bilingues en sumérien et akkadien, pour la plupart des accords de commerce, des lois sur la propriété ou des rituels, sont des exemples de traduction professionnelle. Les scribes étaient des médiateurs centraux dans les sociétés multilingues.
L’Épopée de Gilgamesh, l’un des textes littéraires les plus anciens, a été traduite dans de nombreuses langues à travers l’empire mésopotamien.
Les premiers traducteurs à cette époque étaient généralement des scribes employés par les palaces ou les temples. Leur rôle n’était pas seulement de passer la langue, mais aussi d’adapter le contenu à la culture et aux pratiques légales.
L’apparition de dictionnaires bilingues sur des tablettes d’argile montre par ailleurs une approche structurée de la traduction, qui préfigure les glossaires et banques terminologiques utilisées aujourd’hui.
2. Traités et diplomatie bilingue (env. 1259 av. J.-C.)
L’un des premiers traités internationaux connus, le Traité de paix égypto-hittite, daté vers 1259 av. J.-C., a été établi en hiéroglyphes égyptiens et en écriture cunéiforme akkadienne (la langue diplomatique à l’époque). Ce document en deux langues illustre le rôle vital joué par la traduction dans la diplomatie internationale, même entre des royaumes rivaux comme les Égyptiens et les Hittites.
Cet accord a mis fin à des années de conflit entre eux. Il existait des copies exactes traduites dans les deux langues pour assurer la compréhension mutuelle. Ces inscriptions en deux langues révèlent ô combien la traduction était utilisée comme instrument politique pour instaurer la confiance et asseoir son pouvoir, en particulier lorsque chaque version représentait son dirigeant en vainqueur.
3. Texte sacré et signification : la Septante (300 à 100 av. J.-C.)
Entre le troisième et le premier siècle av. J.-C., des érudits juifs à Alexandrie ont traduit les Saintes Écritures écrites en hébreux en grec, créant ainsi la Septante. Ce n’était pas une traduction littérale, mot-à-mot. Les scribes se sont concentrés sur le sens et l’accessibilité. Cette approche a engagé l’un des plus vieux débats de l’histoire de la traduction : fidélité ou lisibilité ?
La Septante a eu une profonde influence sur le christianisme primitif, car elle a été largement lue et citée dans le Nouveau Testament. Elle a créé un précédent dans la traduction des textes sacrés. En effet, la préservation de la spiritualité prenait souvent le pas sur le respect rigide de la structure. Cette période marque le moment où la traduction a commencé à façonner l’identité religieuse et l’interprétation doctrinale.
4. Héritage latin et voix vernaculaires (IVe au IXe siècle)
L’Europe médiévale dépendait énormément du latin. Toutefois, des figures comme Saint Jérôme, qui a traduit la Bible en latin, appelée la Vulgate, et Alfred le Grand, champions des traductions en ancien anglais, ont joué un rôle central dans la traduction de textes religieux et philosophiques dans les langues locales. Ces traductions ont fait basculer le pouvoir des institutions vers le peuple.
La Vulgate de Saint Jérôme a été la Bible officielle de l’Église catholique pendant plus d’un millénaire. Quant à Alfred le Grand, ses efforts en faveur de l’éducation du clergé et d’un public plus large dans leur langue maternelle visaient à promouvoir l’alphabétisation et l’enrichissement intellectuel. Ces événements marquent la transition de la traduction comme savoir réservé aux élites à un bien public.
5. Connaissances en or : le mouvement de traduction en arabe (VIIIe au Xe siècle)
Du huitième au dixième siècle, l’âge d’or de l’Islam a connu un énorme effort de traduction dans la Maison de la sagesse de Bagdad. Les textes en grec, en persan et en sanskrit étaient traduits en arabe par des polymathes comme Hunayn ibn Ishaq, dont les traductions des textes médicaux de Galien ont eu une influence prépondérante sur la science de l’Orient comme de l’Occident. Un âge d’or dans l’histoire de la traduction.
La traduction était financée par le pouvoir et considérée comme un devoir moral. Les traducteurs adaptaient et amélioraient les textes anciens en y ajoutant des commentaires. Ce mélange de connaissances finit par inonder l’Europe, alimentait la Renaissance. Les versions arabes d’Aristote, par exemple, sont devenues des piliers des programmes universitaires européens.
6. Tolède, une collaboration multiculturelle (XIIe au XIIIe siècle)
Dans l’Espagne médiévale, Tolède est devenue un centre où intellectuels chrétiens, juifs et musulmans traduisaient les travaux arabes en latin. Grâce à ces efforts, les philosophes comme Aristote reprirent une place dans le discours en Europe, ce qui a catalysé la Renaissance. Cette collaboration multilingue reste un brillant exemple de la façon dont la traduction nourrit les connaissances au fil des siècles.
On peut observer que la traduction se faisait souvent en deux temps : un locuteur arabe traduisait d’abord dans une langue romane locale, puis un intellectuel chrétien le traduisait en latin. Le travail était chaotique, multilingue et hautement collaboratif, preuve que la traduction a toujours été une affaire de personnes unissant leurs forces.
7. L’arrivée de l’imprimerie : l’empreinte de Gutenberg (1444)
Lorsque Johannes Gutenberg a mis au point la presse à caractères mobiles en Allemagne en vers 1444, son invention a révolutionné la façon dont on sauvegardait, reproduisait et traduisait le savoir. Pour la première fois de l’histoire, des livres pouvaient être produits en masse, ce qui réduisait fortement les frais et le temps de production en comparaison avec l’écriture des textes à la main.
Cette invention a accéléré la traduction des textes religieux et savants, diffusant le savoir à plus grande échelle dans de nombreuses langues. Des textes centraux comme la Bible n’ont pas attendu longtemps avant d’être traduits et diffusés dans toute l’Europe, augmentant l’alphabétisation et modifiant l’éducation ainsi que la religion. La presse typographique constitue le fondement de l’édition et de la localisation.
8. Foi en la transmission vernaculaire : la Bible de la Réforme (XIVe au XVIIe siècle)
Les réformateurs religieux comme Martin Luther (Bible en allemand), William Tyndale (Nouveau Testament en anglais) et John Wycliffe (Bible de 1382 en anglais) ont révolutionné l’accès aux Écritures. La Bible du roi Jacques (1611) est devenue l’un des textes les plus influents en langue anglaise. Ces travaux ont redéfini la relation entre la langue, la foi et l’identité.
Traduire dans ce domaine était un acte radical, punissable de la peine de mort. Tyndale a été exécuté pour son travail, alors que la traduction de Luther a aidé à normaliser la langue allemande. Ces bibles n’ont pas seulement changé la religion, elles ont façonné les identités nationales et le développement des langues européennes modernes.
9. La pierre de Rosette ou comment déchiffrer les hiéroglyphes d’une civilisation (écrite en 196 av. J.-C., découverte en 1799)
Découverte en 1799, la pierre de Rosette présente un décret écrit en grec, égyptien démotique et hiéroglyphes égyptiens en 196 av. J.-C. Elle a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer l’égyptien ancien, devenant ainsi l’un des objets les plus célèbres de l’histoire de la traduction. Sans la pierre de Rosette, de vastes pans de l’histoire écrite de l’Égypte seraient restés inconnus.
Son importance réside non seulement dans son contenu, mais aussi dans le fait qu’elle porte trois écritures. En comparant les mystérieux hiéroglyphes au texte en grec qu’ils comprenaient, les linguistes ont élaboré une méthodologie qui a dévoilé des milliers d’années de la civilisation égyptienne. La pierre de Rosette est ainsi devenue un symbole du décodage linguistique.
10. Théorie de la traduction : de Cicéron à Schleiermacher (de 100 av. J.-C. au XIXe siècle)
La Renaissance n’était pas qu’art et science, elle a aussi repensé la traduction. Les penseurs romains comme Cicéron et, plus tard, le philosophe allemand Friedrich Schleiermacher, ont introduit une idée d’opposition : une traduction doit-elle sembler naturelle au lecteur ou préserver l’élément d’étrangeté du texte source ? Ce débat entre domestication (localisation) et étrangéisation reste central dans l’histoire de la traduction jusqu’à aujourd’hui.
Cicéron et Horace donnaient la priorité au sens, particulièrement dans les contextes rhétorique ou poétique. Quant à Schleiermacher au XIXe siècle, il défendait la préservation de l’élément d’étrangeté du texte source. Ces idées sont le terreau de la traductologie moderne et de l’évolution du rôle du traducteur en tant que médiateur et force créatrice.
11. Précision et érudition : des Lumières à l’ère industrielle (XVIIIe au XIXe siècle)
Avec la diffusion des encyclopédies, des livres de grammaire et l’expansion des sociétés académiques, les XVIIIe et XIXe siècles ont vu l’arrivée de la traduction professionnelle. Le penseur chinois Yan Fu a fait connaître les textes scientifiques de l’Occident en chinois en mettant en pratique une théorie de la traduction unique : « fidélité, expressivité et élégance ».
À cette époque, les académies nationales établissaient des normes linguistiques et les traducteurs ont travaillé au service de l’empire, de la science et de la diplomatie. Les traductions de Yan Fu ont par exemple fait connaître le darwinisme en Chine et ont reflété un important changement, soit la traduction comme vecteur de modernisation et d’indépendance intellectuelle.
12. La première traduction par une machine (1954)
En 1954, Georgetown University et IBM ont mené la première expérience publique de traduction automatique, qui consistait à traduire 60 phrases en russes en anglais, sur la base de six règles de grammaire. Bien que rudimentaire, cette traduction a marqué un nouveau chapitre dans l’histoire de la traduction : la linguistique computationnelle était née.
Cette démonstration a créé de l’espoir quant à l’automatisation, notamment pendant la Guerre froide, où les traductions russe-anglais étaient très demandées. Même si le progrès a été moindre qu’espéré, l’expérience a ouvert la voie à des décennies de recherches et jeté les bases des machines de traduction modernes.
13. La traduction se dote d’outils : TAO et MT (années 1990)
À partir des années 1990, les traducteurs ont commencé à utiliser des outils de traduction assistée par ordinateur (TAO). Des logiciels comme Trados ont popularisé les mémoires de traduction (MT) et les bases terminologiques, qui permettaient d’accélérer le travail répétitif et d’améliorer la cohérence. Ces outils ont transformé la façon de travailler des traducteurs professionnels.
La TAO n’a pas remplacé les traducteurs, elle les a équipés. En retrouvant des phrases précédemment traduites, les traducteurs peuvent se concentrer sur les détails tout en assurant la cohérence. Cette évolution a permis de développer des projets de localisation à grande échelle et des stratégies de contenu multilingue à l’ère numérique.
14. Réseaux neuronaux et IA en temps réel (dès 2010)
Dès les années 2010, la traduction automatique neuronale (NMT) a permis de nettement améliorer la fluidité et la sensibilité au contexte des machines. Des services comme DeepL et Google Translate génèrent des traductions assez correctes rapidement. Toutefois, ces outils passent à côté de la nuance, du ton ou du contexte culturel, ce qui rend un contrôle humain indispensable (post-édition).
La NMT ne se base pas sur des règles ou des statistiques comme ses prédécesseures, mais apprend à partir d’énormes quantités de données. Elle prédit des structures de phrase entières, dont le résultat parait plus fluide et naturel. En ce qui concerne les contenus spécialisés ou sensibles, un traducteur professionnel reste cependant irremplaçable.
15. Le facteur humain : pourquoi les traducteurs sont et resteront indispensables
Bien que la technologie ait fait d’énormes progrès, la traduction reste une entreprise profondément humaine. Les théoriciens comme Lawrence Venuti et Damion Searls montrent à quel point le ton, le sous-texte et le rythme émotionnel défient les algorithmes. L’intuition culturelle et le jugement éthique ne peuvent pas être automatisés facilement. La post-édition reste l’une des interventions humaines les plus importantes dans un processus de traduction automatique.
La langue est intimement liée à l’identité, la signification va au-delà des mots. Que ce soit pour traduire des contrats, de la poésie ou des slogans marketing, les traducteurs lisent entre les lignes. Ils s’assurent que le message est rendu fidèlement ; il est important de choisir les bons mots.
Pourquoi SwissGlobal attache de l’importance à l’histoire de la traduction
- Un pont à travers les époques : nous nous appuyons sur des milliers d’années de traduction pour pouvoir rendre service à votre organisation aujourd’hui.
- La technologie au service du résultat : certes les outils sont puissants, mais l’expertise humaine assure la qualité et la fiabilité.
- Pertinence culturelle : chaque mot doit être porteur de sens au-delà des frontières et des secteurs d’activité.
- Quand la tradition rencontre l’innovation : comprendre le passé nous aide à préparer une communication d’avenir.
Chez SwissGlobal, nous rendons honneur au passé tout en travaillant avec les dernières technologies de traduction ; là où la langue est synonyme de confiance et où les mots font bouger le monde. Contactez-nous sans attendre pour tous vos projets de traduction.
-
Histoire de la traduction
Sprachdienstleistung
traduction